La naissance d’un traité
Négociations
La bonne foi est nécessaire pour faire un traité. Un traité écrit par texte sera donc conclu.
Adoption du texte
Authentifier
Le traité est fixé par son adoption, qui doit être faite par un vote. Avant ce texte était toujours authentifié. Ceci ce faisait par les paraphes (iniciales du delegué par exemple). Comme ça on s’assure que tout le monde à conscience de quel texte a été accepté, puisqu’il y a normalement beaucoup.
Signer
La signature n’implique pas que l’état soit lié. C’est pas un contrat. Signataire ne veut pas dire partie de. Alors c’est quoi l’intérêt de signer? Elles authentifient le textes, parfois par moyen de (ou tout comme) les paraphes. Les signatures mettent en marche les dispositions qui accompagnent le traité. Signer= aider à mettre en vigueur le texte. C’est suivre la procédure jusqu’à l’entrée en vigueur. Le soumettre aux autorités par exemple. Mais il est possible de voter contre après. Quand il entre en vigueur il faut aussi faire une cour, préparer des normes institutionnelles, etc. Les signataires aident à cela.
En plus, il y a l’article 18 de la CdVT. L’état signataire est obligé à certaines obligations:
- Pas faire des actes qui privent le traité de son but, on ne peut pas le tortiller ou essayer de faire tomber ses objectifs à l’eau. Si on n’aime pas un traité on doit le notifier et pas signer.
- Exemple: Deux états veulent baisser les droits de douane. A et B, dans un traité pour un produit determiné. 50% de baisse. L’état B se dit, on pourrait ne pas baisser les droits que jusqu’à que le traité soit en vigueur. On double les droits et après on les baisse quand le traité commence. L’état A ne fait pas cela et perd. Le traité est privé de son sens.
- Dans la vie réelle les choses ne sont pas si simples. Déterminer si un acte est de mauvaise foi et vise à détruire un traité est en réalité plutôt complexe. C’est ça le travail d’un juriste de DIP.
Ratifier
Consentement à être lié par le traité de manière définitive. Les affaires étrangères envoient une lettre au dépositaire du traité (état choisi pour les fonctions administratives du traité), pour leur faire savoir qu’ils veulent être liées par ce dernier. Depuis le moment où l’état reçoit la lettre le ratifiant est lié. Pas par sa signature mais par cette lettre.
La ratification peut se faire après la signature (parfois même des ans). Un état démocratique (au contraire des autoritarismes) ne peut pas juste signer et ratifier. Il est nécessaire de confirmer avec le reste des organes (c’est pas juste l’exécutif qui négocie et ratifie). Le parlement, et parfois le peuple comme dans la CH, doit l’accepter. Si le parlement vote oui, le traité n’est pas ratifié, ceci est une autorisation pour l’exécutif. C’est juste une procédure de ratification au niveau de droit constitutionnel dans quelques états mais pas reconnue par le DIP.
- Exemple: Après les événements du 11/9/2001 les traités de sécurité n’ont pas été ratifiés mais certains états ont attendu puisque les choses allaient changer, se lier n’avait pas de sens.
Parfois, pour des traités de moindre importance les dispositions peuvent souligner que signer=ratifier (ceci est rare) ou il est tellement facile de faire passer le traité par le parlement (peut-être même pas nécessaire) donc la ratification vient immédiatement après la signature. Par exemple pour les traités dont le droit constitutionnel n’exige pas l’approbation des autres organes.
Quand on fait une conférence et on invite des états, si ces états signent le texte conclu ils ont une obligation de droit subjectif pour le ratifier. Si un traité prévoit que les tiers deviennent partie, donc les états pas invités, ils doivent le faire selon certaines conditions. C’est l’adhésion, qui ne permet pas de ratifier. Dans les traités de l’ONU il y a deux colonnes pour ces deux catégories d’états.
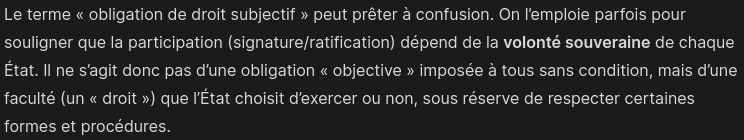
Entrée en vigueur
- Certaines ratifications/adhésions.
- Un certain événement/date.
- Par exemple la CVdT, qui a rentrée en vigueur 30 jours après 35 participations (le 35ème instrument de participation).
Dans les lois intérieures, le législateur dit à quelle date une chose rentre en vigueur grâce à son autorité. Mais pas dans le DIP. Par exemple pour la CVdT après le 35ème état ils est possible de continuer à y adhérer, il y a des dates d’entrée en vigueur mobiles. Tout le monde n’a pas la même. Normalement la CVDT entre en vigueur pour un état 30 jours après leur adhésion. Et internationalement elle n’a pas été en vigueur avant le 27 janvier 1980.
Lorsque le traité n’est pas encore en vigueur (selon article 25 CVdT) et il y a une nécessité de faire entrer quelques parties du texte en vigueur provisoirement (ou tout le texte), peuvent le faire à travers d’un accord collateral. Des fois si le traité n’entre finalement pas en vigueur il faut revoir ces accords provisoires.
La Charte des Nations Unies dicte que les membres des Nations Unies doivent soumettre leur traités (traités internationaux) aux services des traités de l’ONU pour leur publications. Ne pas le faire est une violation mais n’a pas d’impact sur la validité du traité, mais il ne pourra pas être invoqué auprès des organes de l’ONU.
Les traités ne sont pas rétroactifs selon la CVdT. Ceci s’applique même à la CVdT. Elle ne s’applique qu’aux traités conclus après l’entrée en vigueur de celle ci. C’est le principe de la rétroactivité. Mais il y a des traités qui vont en contre de cela, même sans présenter des dispositions explicites. C’est par leur interpretation. Comme les accords sur la liquidation d’un conflit armé, celui régi des faits antérieurs puisqu’il rentre en vigueur après le conflit.
On peut pas condamner les génocides commis avant la convention contre le génocide.
Réserves
Des choses peuvent se produire pendant les négociations (multilatérales, les réserves concernent que ce type de négociations). Normalement les états ne sont pas d’accord sur tout, pas dans la pratique au moins. Dans la théorie ceci est possible. Certains états peuvent être contre le tournant qui prennent les négociations, et n’en veulent pas du tout de ce traité. Mais il y a des états qui ne sont pas totalement en désaccord. Par exemple un certain article ne permettrait pas de passer le vote du parlement ou est contre la constitution.
Les réserves n’existent pas pour détruire le cœur du traité, c’est l’accommodation des positions des états en doute. Dans la SdN, et dans le passé en général, quand les états étaient moins nombreux c’était juste une questions de négocier et arriver à un traité définitif. Après ça pas plus de pétitions supplémentaires. Mais ça c’est pas bon, ça résulte dans un traité multilatérale sans beaucoup de soutien et donc marginalisé. L’ère de l’ONU à vu naître les réserves. Un état adhère mais ne l’applique pas intégralement. Il fait des exceptions ou applique certaines choses différemment. Il y a donc une pluralité de versions d’un même traité ce qui complique les choses. Il est possible de faire une réserve au moment de l’adhésion et elle doit être confirmée au plus tard dans la lettre de ratification. Pas plus tard.
La réserve est circulée par le dépositaire parmi les autres états ratifiants, une seule objection l’écarte.
Dans le droit moderne un état est libre de faire des réserves, sans limites. Normalement le nombre de réserves n’est pas considérable, sauf dans des cas toxiques.
Certains traités ont des dispositions pour limiter les réserves, sinon ils sont silentieux sur ce domaine. Normalement ceci est noté sur les dispositions finales. C’est normale d’avoir des dispositions pour régler les réserves quant au propre traité. Dans les traités silentieux le droit général ou la convention de vienne s’applique si l’état l’a ratifiée. S’il n’est pas silentieux alors le droit particulier s’applique et des fois on ne peut même pas faire des réserves. D’autres fois on limite les réserves à certaines dispositions, ou à l’inverse on les interdit plutôt pour quelques dispositions. Les réserves de type générique sont des fois interdites, et en général pas appréciées/recommandées. Il faut être spécifique. Par exemple la Suisse quand elle se réserve le droit cantonal.
Traité restreint
Traité restreint par la volonté de certains états qui veulent maintenir l’esprit du traité, on n’attend pas de réserves.
Traité institutionnel
La création d’une OI, les réserves ne sont pas admises. Sauf si l’organe compétent de l’organisation l’accepte, ou l’acte constitutif (ce traité institutionnel) en dispose autrement. Au sein des OIs il y a toujours des organes de compétences résiduelles. Comme dans le cas de l’ONU, la UNGA (ils s’occupent aussi de ces problèmes souvent).
Disposition limitant les états dans leur liberté
On limite les réserves qui s’opposent à l’objet/but du traité. Art. 19 de la CVDT. Dans un traité il y a des dispositions importantes pour le but/réalisation juridique du traité et certaines secondaires. Certaines fois déterminer ceci est difficile d’un point de vue juridique. Par exemple: les réserves des états arabes (sharia) aux conventions pour la protection des femmes/enfants. Elles sont générales (X état se réserver le droit de la sharia…). Il est peut-être facile de déterminer que cela va en contre du but du traité mais pas facile de solutionner politiquement. Ces réserves ont été considérées incompatibles.
Les états essaient de ratifier quand même, pour ne pas être pointés du doigt.
Dans la convention contre le génocide on voulait protéger l’article (8, création d’une cour internationale), l’URSS voulait ratifier pour ne pas être mis en évidence. Elle essaie d’annuler à travers une réserve l’article 8. Les pays socialistes/est étaient pour et les occidentaux en contre. L’article 8 était nécessaire pour pouvoir protéger le but. Mais les socialistes disaient que la cour n’était qu’un moyen de régler les différends (pas essentiel). Des fois le problème est trop subjectif.
Violation de droit des traités
- Réserves dans un traité avec disposition contre réserves (nulle).
- Réserves contraires à la CVDT (nulle).
- Contraires à l’objet ou but. Opposabilité/Opportunité (difficile de savoir si une réserve est contraire au but, les états peuvent s’opposer et elle ne s’appliquera qu’aux états qui la considèrent vraie) vs nullité (on peut pas accepter, soutenu par la CH à un moment donné).
Réserves valides
Art. 21 CVDT. Si une réserve est valide il y a plusieurs traités en fonction des relations bilatérales (ceux qui acceptent (ou pas) une réserve).
- État A→Réservataire, partie de la convention. N’appliquerait le traité qu’avec la réserve.
- État B→ Partie de la convention, accepte la réserve.
- À ce moment on applique le traité avec un plein effet de la réserve entre A et B.
- Contenu exclusif (exclue une disposition)/modificatif (modifie une disposition).
- État C→ Partie de la convention. Ne réagit pas pendant 12 mois à la réserve, la CVDT assume qu’il consent.
- État D→ Partie de la convention, objecte. Refuse d’appliquer la convention avec A. Objection robuste/indicale, plusieurs noms. Il peut aussi juste exclure la réserve. Ceci serait une objection simple. Dans ce cas on exclut seulement l’article sur lequel se greffe la réserve d’A. Ceci est réciproque, accepter une réserve veut dire qu’elle s’applique aux deux états sinon ceci entraînerait une inégalité profonde.
Déclaration interpretative
Ceci est très populaire en Suisse aussi. Les états utilisent la ratification pour dire quelque chose à propos d’un traité. C’est une déclaration qui n’impacte pas les droits et obligations du traité. La distinction dépend de l’interpretation. Certains états font des déclarations de politique (ex: ils ne reconnaissent pas un certain état). Par exemple le Mexique dans les années 50 a saisi l’occasion de ratifier la convention sur les réfugiés pour dire qu’il va accueillir des réfugiés même quand ils ne remplissent pas les conditions ratifiées.
Validité des traités
Il y a des dispositions dans la CVDT (Art.46(régit la conclusion du traité)-53) et le droit des traités pour déterminer la validité de ces accords. Le défaut de la libre volonté par example le rendrait invalide. Il y a très peu d’exceptions, les traités sont très protégés. Ce type de droit a vu le jour avec la charte de l’ONU. Les traités inégaux et faits sous coercitions étaient permis avant. Les traités de paix étaient les plus important à cette époque et ils étaient faits par coercition en quelque sorte.
La stabilité des traités est importante pour la CVDT, on ne veut pas le unilatéralisme. Il est mieux d’éviter de donner/permettre d’inventer des raisons de nullité. Les traités doivent être contraignants, et donc on spécifie quelles sont les uniques raisons pour lesquelles on peux les rendre invalides.
Si le mandat du négociateur change il est nécessaire de notifier, certains traités le demandent. Si on ne le fait pas il pourrait être nécessaire de nullifier le traité.
Violation interne
Tromper un état est difficile, tout comme la corruption. Si un état est trompé il est possible d’annuler la ratification. Mais cela n’arrive presque jamais. Ce qui arrive c’est la coercition. Aussi des fois on viole le droit constitutionnel et on ratifie directement le traité, ou d’autres choses arrivent (ex: le parlement approuve mais on a mal compté les votes). L’article 46 ne concerne que la conclusion et pas la contradiction entre droit interne et international dans les traités. C’est pas du droit des traités ça. Le défaut commis en droit interne en plus, n’est pas une excuse pour annuler le traité. Sinon il serait possible de commettre une erreur de procédure pour pouvoir annuler le traités après-fait. Mais il y a une exception, si la violation est très importante. Par exemple un délegué qui dispose du territoire national. La violation doit aussi être manifeste pour les co-contractants. Il n’y a jamais eu un cas en DIP où l’argument de nullité a été accepté. Comme dans le cas de l’affaire Guinée-Bissau(Portugal)←>France pour la délimitation de la mer territoriale (la violation était fondamentale mais la France ne connaissait pas bien le régime de Salazar et son droit interne). Il n’y avait même pas de CVDT en vigueur en cette époque.
Coercition
51-53 de la CVDT. S’il y a une contrainte imposée sur le représentant le traité est nul. Ceci est aussi aligné avec la Charte de l’ONU. Ceci n’est pas une question de coercition économique, politique, etc; mais juste une coercition sur le représentant ou la coercition physique à l’état: Soit tu acceptes le traité, soit je te bombarde.
Contenu
Le jus cogens. La nullité d’un traité en raison de son contenu. Deux états qui se mettent d’accord pour commettre un génocide, par exemple. Parfois ceci est compliqué, comme dans le cas de traités pour l’usage de la force mais dans le cas de la légitime défense. Ceci est contenu dans l’article 53 mais aussi 64.
- 53→traité nul à cause d’une règle impérative existante (n’a jamais existé juridiquement, rétroactif).
- 64→extinction d’un traité conclu dans le passé par une nouvelle norme impérative.
Nullité (ou annulité) absolue/relative
Absolue
Dès que le motif de nullité existe le traité est nul sans intervention pour l’annuler ou le sauver.
- Ex: Art. 53.
Dans ce cas l’intérêt collectif est en péril.
Relative
Le traité reste valide malgré le défaut, jusqu’à que l’état affecté par le défaut évoque la cause de nullité (délai raisonnable non standard, si on ne fait rien il faut assumer qu’on s’en fout→acquiescement). Mais comment savoir quand un état découvre l’erreur? On ne peut pas.
- Par exemple une erreur fondamentale dans le traité.
Dans ce cas les intérêts de l’état qui a subi l’erreur sont ceux qui sont en cause. C’est pour ça que c’est lui qui décide.
Séparabilité
Est il possible de mettre de côté la disposition dans laquelle il y a une erreur? Non. Tout le traité est frappé. Sauf:
- Art. 44 CVDT (séparable dans certains cas ou la disposition n’est pas essentielle pour le but du traité et la séparation est juste pour toutes les parties).
États tiers
États qui ne sont pas partie d’un traité, c’est les états tiers lesquels n’ont pas d’obligation envers le traité. Art. 34-38 de la CVDT. Le principe général est que les états tiers ne peuvent pas subir des obligations par rapport à un traité duquel il ne font pas partie ni jouir des droits qu’il confère (Art. 34).
Ce sont les droits et obligations qui intéressent le droit et un tiers n’est pas concerné par ceux là. Mais le traité peut avoir des effects sur les états. Mais ceci c’est des conséquences de fait, les états peuvent y réagir mais cela est une matière politique. Le DIP ne s’intéresse qu’à que les droits subjectifs et obligations soient respectés.
Ce principe est renforcé par la souveraineté d’un état et par le fait (art. 38) que lorsqu’un traité reflète des normes du droit coutumier tous les états sont liés. Mais c’est pas les traités qui les lie, c’est la norme.
Exception
Art. 35 (obligations),36 (droits subjectifs). Accord collatéral. Un état ou plusieurs sans être partie au traité peuvent décider d’assumer/jouir de certain(e)s obligation/droits subjectifs. Donc ils peuvent s’arranger par un traité collatéral avec les états qui font partie du traité.
Il faut l’acceptation exprèse (pour les obligations) et par écrit de l’état tiers. C’est rare dans le CVDT d’exiger une telle formalité. Mais la CVDT estime qu’un état qui accepte cela est tellement inhabituel qu’on veut s’assurer d’une modalité de preuve. Mais ceci arrive, par exemple:
- Dans les années 50 l’Egypte accepte unilatéralement que le canal (maintenant nationalisé) il appliquerait les obligations issues de la convention de Constantinople pour les canaux internationaux ce qui concède certains droits aux états passants.
Dans le cas des droits subjectifs il faut toujours un accord collatéral mais l’état bénéficiaire peut rester silencieux, il n’a pas à l’accepter puisque c’est une chose positive. Il y a eu un cas très célebre:
- L’affaire des droits douaniers du pays de Gex, qui permettaient à Genève d’importer des biens de cette zone voisine (positif pour la Suisse). Même si la Suisse n’était pas aux congrès de 1815 quand cela a été décidé. La France a essayé de changer cela mais elle ne pouvait plus. La suisse l’avait acquis.
La charte de l’ONU (art. 35) dit que les états peuvent l’avertir d’une situation qui met en péril la paix internationale. Quand on donne un droit/obligation à un état. L’article 37 dit aussi que cela est révocable. Les états qui donnent un droit à un état tiers peuvent le révoquer mais cela est sujet à interprétation. Si l’objectif était de donner un droit irrévocable alors non cela n’est pas possible.
Il y a aussi des traités avec des structures particulières. Comme ceux des droits de l’homme. Ils sont triangulaires, pas sujets à la réciprocité. Ils donnent des droits à des individus. Les états se promettent de donner des droits à un tiers, les humains. Il y a pas des états tiers mais des individus qui ne sont pas partie d’un traité. Il y a des traités qui fonctionnent différemment à d’autres comme celui là.
Y a-til d’autres exceptions? Peut-on imposer ces conditions? Les régimes territoriaux objectifs sont le cas. Par exemple l’Antarctique. Ce n’est pas le traité qui a un effet sur les tiers mais les effets de celui-ci (démilitariser, gouvernement international, etc). Et elles ne sont pas méconnues pour les tiers, qui sont contraints dans leur actions.
Interprétation
Art. 31-33 de la CVDT. Ce sont les joyaux de la couronne de la CVDT, personne n’interprète un traité sans se référer à ces dispositions. Il y a deux facettes:
- Sens d’une disposition. Chaque norme a un but. L’opérateur juridique essaie de comprendre ce que le législateur voulait donner comme sens à la disposition qu’il est amené à interpréter. Ceci n’est pas tout, c’est pas juste interpréter les mots.
- Donner un sens à la disposition. Quand la volonté n’est pas claire ou ne répond pas aux questions de l’interprète à cause du passage du temps ou etc.
Qui peut interpréter
Tout le monde peut le faire. Mais seulement certaines comptent pour le DIP:
- Auto-interprétation: En droit interne elle a le premier mot mais en DIP c’est souvent le dernier. Quand on doit appliquer le traité il faut comprendre ce qu’il faut faire. Les traités à la base sont interprétés par chaque état. Si cela pose des problèmes entre états et doivent s’accorder.
- Interprétation authentique: L’interprétation de tous les parties du traité. Lorsque l’accord est trouvé ils sont liés et cette interprétation est figée.
- Il y en a bien plus.
- Interprétation judiciaire: Il est possible de soumettre des différends à un juge. Le jugement lie les parties à la procédure. Pas le reste. Arbitage, CIdJ, tribunal de recours du droit de la mer, etc. Jamais la CIdJ a eue tellement d’affaires comme aujourd’hui btw.
Objet de l’interprétation
En premier le texte? Volonté? Qu’est ce qu’on fait en premier, c’est la controverse de tout ordre juridique. Pourrait le texte ou la volonté résoudre le conflit? Des fois il n’y a pas d’oppositions entre elles. Mais ça arrive et la CVDT donne la priorité aux textes. Ceci pour des raisons de sécurité et égalité entre les états qui font partie du traité. Donc la volonté des ratifiants primerait sur celles des adhérants dans les cas échéant, ceci détruirait l’ordre horizontal sur lesquels les états faisant partie des états sont placés. Le texte est le meilleur témoin de la volonté, si quelque chose n’est pas dans le texte et ben on pourrait juste l’inventer. La CVdT cherche l’interprétation objective et pas subjective.
Comment interpréter?
Art. 31-33 de la CVDT:
- Art. 31→ 4 éléments.
- Art 31 paragraphe 1 et 3→ contexte et paragraphe 2 contexte à la conclusion du traité. Des fois les états concluent plus d’un paquet ou ils adoptent des actes sur le traité. On tient compte de l’ensemble s’il y a des textes liés. Le contexte incorpore des éléments qui viennent après la conclusion. Cette pratique montre que les états ont interprété le traité d’une certaine façon. On prend aussi en compte le préambule.
- En plus le traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire attribué au traité dans le contexte et dans la lumière dès son objet et son but. 4 éléments principaux: bonne foi, sens, contexte, objet et but. En plus du contexte, pratique ultérieure, etc.
- Il n’est pas possible de dissocier ces 4 éléments. Il faut de l’expérience pour interpréter, c’est par une science mais une art. Il faut savoir intégrer ces éléments.
- Trousseau à clés, chacune avec une forme et longueur différentes. Avec de l’expérience on peut voir quelle clé peut peut-être ouvrir une serrure quand on la voit. On essaie et en trouve la manière de solutionner l’interprétation, s’il y en a une.
- Selon le traité on interprète d’une certaine manière. Avec un traité normatif on essaye de donner un sens stable aux dispositions pour l’appliquer avec sécurité. Comme ça on donne à la disposition un sens conforme à la vérité générale du texte et on l’applique de manière cohérente dans le futur.
- Dans les bilatéraux on essaye de rendre justice au problème spécifique posé. Ils sont un objet particulier sans une grande projection sur l’échelle internationale. Ceci doit être pris en compte, l’interprétateur ne cherche pas toujours le même but.
- Art. 32: moyens complémentaires d’interprétation. Ensemble des actes de négociation de traités. Les débats et etc. C’est les travaux préparatoires. On l’utilise que pour complémenter le sens obtenu selon l’article 31. On se tient au texte.
- Art. 33: Traités plurilingues comme la charte de l’ONU. Il peut avoir des divergences linguistiques. Les parties ont adopté un traité dans plusieurs langues dans la version authentique et donc cela s’applique. La dernière disposition pourrait dire que plusieurs langues font foi. Mais sinon on applique pas l’article. Et on n’applique pas les traductions en plus.
Sens de l’interprétation
L’article 31 de la Convention de Vienne dit qu’il faut interpréter un traité de bonne foi en se référant au sens ordinaire des termes, dans leur contexte, et à la lumière de l’objet et du but du traité:
- Sens ordinaire (interprétation grammaticale): on commence par voir le texte. Comme ça on recherche la sécurité juridique les états cherchent à stabiliser les normes mouvantes du DIP à travers des traités donc on cherche la sécurité. Le sens ordinaire est accesible à tous au contraire de la volonté. C’est le sens le plus raisonnable et objectif. Le sens le plus naturel des mots. Il y a quand même le sens spécial dans le sens ordinaire. On peut pas ignorer le contexte et juste tenir en compte ce que les mots disent le plus souvent. On va utiliser le sens qu’ils ont dans le contexte du traité. Il devient donc le sens ordinaire plus qu’on est dans une branche/matière spécifique. Les parties peuvent aussi s’accorder sur l’utilisation d’un sens spécial (on doit le prouver) dérogatoire du sens ordinaire.
- Exemple: Affaire Groenland Danemark et Norvège à la CIdJ.
- Contexte: Interprétation systématique. Quand on veut interpréter un élément comme un mot on essaie d’élargir la vision. On regarde la phrase, le paragraphe, la disposition, la section, etc. On peut aller vers d’autres traités liés au traité qu’on veut interpréter. Exemple: Affaire plateformes pétrolières USA-Iran.
- Bonne foi: Ça veut dire deux choses (la première plus fréquent et la deuxième plus distinctive).
- Renforcement du sens ordinaire
- Interpréter de bonne foi, c’est rester fidèle au sens normal des mots, c’est-à-dire ne pas chercher à tordre le texte pour lui faire dire autre chose que ce que les États signataires pouvaient raisonnablement attendre.
- L’idée est de protéger les attentes légitimes : si tout le monde comprend le texte de telle façon, on ne va pas inventer une interprétation farfelue pour en tirer avantage.
- Tempérament à la textualisation excessive
- Cela veut dire qu’il ne faut pas se limiter bêtement à la lettre du texte quand cette lecture hyper-littérale trahirait l’esprit ou le but du traité.
- En d’autres termes, la « bonne foi » sert aussi à éviter qu’on “abuse” du texte (par des interprétations trop fines ou trop rusées) pour contourner la règle ou l’intention réelle du traité.
- Renforcement du sens ordinaire
- But (interprétation téléologique):
- Objet: matière soumise à réglementation.
- But: finalité du traité. La raison de la loi.
- Quand on sait quel est le but on peut mieux interpréter le traité.
- Plus difficile à interpréter. Il y a des versions appelées télésubjectives et téléobjectives. Il est possible de chercher à déterminer ce que le législateur voulait ou regarder l’objet et le but tel que le texte les présente. Le but peut évoluer dans le temps, il est pas statique.
- Il y a des interprétations restrictives et extensives.
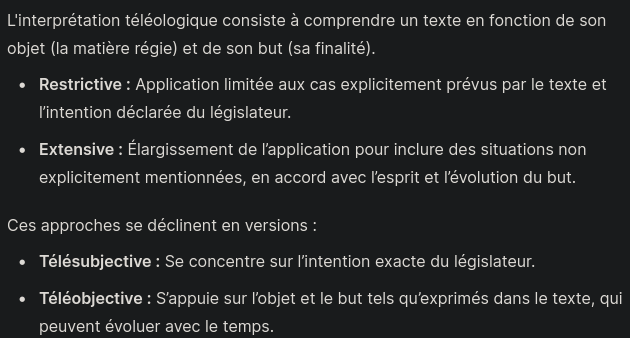
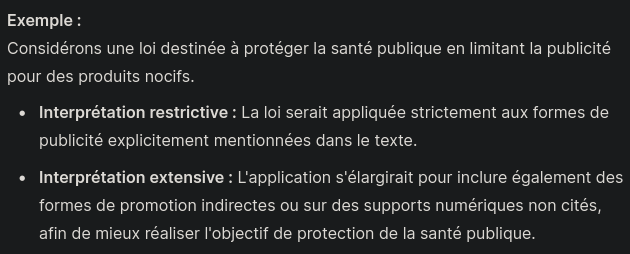
- Ceci donne de l’autonomie pour l’interprétation. L’interprète peut choisir d’interpréter selon le but, pour le faire plus efficace dans un seul sens. Mais là il y a un risque, aller de l’interprétation vers la révision pour l’améliorer. Ceci n’est pas le rôle de l’interprète, il ne doit pas faire un meilleur traité.
- Interprétation historique/évolutive. On interprète un texte en tenant en compte le contexte dans lequel il a été écrit et l’évolution de la norme pour s’adapter aux nouveau temps.
Principe d’interprétation conforme
Quand il y a un conflit entre droit interne et externe le pays essaie d’harmoniser l’interprétation du droit interne pour qu’il ne soit pas en contre du droit externe.
Effet utile
L’effet utile est un principe d’interprétation qui vise à assurer que les normes juridiques produisent un résultat concret et efficace. Autrement dit, lorsque plusieurs interprétations sont possibles, celle qui garantit l’application pratique et effective de la norme est privilégiée. Ce principe évite une interprétation purement littérale qui pourrait rendre la règle inopérante ou vide de sens.
Pratique subséquente
Pratique subséquente (subsequent pratice). Importante pour tous les traités. Surtout massive dans le domaine des traités institutionnels. Les OIs évoluent avec le temps, selon la politique. Il est nécessaire que la pratique adapte la charte, mais cela ne peut pas se faire constamment. Ex:Art. 27 paragraphe 3 charte ONU: Dans l’UNSC s’abstenir=veto. Ceci a été changé par la pratique subseconde et puisque personne s’est opposé cela devient partie de la Charte.
Du même genre
Il s’agit d’interpréter une norme en se référant à des règles ou situations similaires. L’idée est d’assurer une cohérence dans l’application du droit en traitant de manière similaire des situations analogues. Par exemple, si plusieurs traités comportent des dispositions analogues pour la gestion d’un risque environnemental, l’interprétation d’une disposition dans un traité pourra s’inspirer de celle des autres.
Interprétation à contrario
Cet argument repose sur l’idée que si une norme énonce explicitement certaines situations, alors, par l’absence de mention, on peut en déduire que les cas non prévus doivent être exclus. Autrement dit, si le texte règle un cas précis, ce qu’il ne mentionne pas se trouve implicitement exclu. Cela permet d’éviter une interprétation trop large qui irait à l’encontre de l’intention du législateur.
Analogie
L’argument par analogie consiste à interpréter ou appliquer une norme en se fondant sur la similitude avec d’autres dispositions ou situations juridiquement comparables. Autrement dit, lorsqu’une situation précise n’est pas expressément prévue ou détaillée dans un texte juridique, on peut se référer à une règle ou un cas similaire déjà établi pour combler le vide juridique et assurer une cohérence dans l’application du droit.
Décider quel argument utiliser dépend beaucoup du but du traité et d'autres facteurs. Ce processus n’est pas mécanique.
Mise en oeuvre
Règle principale
Le caractère contraignant des traités, on a des droits et des obligations. Les obligations doivent être mises en oeuvre, puisque les états se sont engagés (principe sacro-saint de l’époque des lumières: pacta sunt servanda).
Invocation
Un état ne peut pas déroger le traité en utilisant des excuses comme leur droit interne. Ceci serait une violation. Un état pourrait unilatéralement modifier le droit interne pour annuler le traité sans cette règle.
Contrôle de l’éxecution
Les traités sont normalement munis de mécanismes de contrôle depuis les années 60. Il y a des cours de justice et des procédures de règlement de différends. Les parties contractantes prennent le traité au sérieux et prévoient la mise en oeuvre du traité.
Présomption d’applicabilité territoriale
Le traité doit être applicable dans l’ensemble du territoire de l’état ratifiant. Il y a des pays ou ceci est plus compliqué (ex: colonies comme la FR ou séparatisme comme la Moldavie.).
Application réciproque
Les traités sont d’application réciproque. Ex: Conflit armé Éthiopie-Éritrée ou les Conventions de Genève n’étaient pas applicable puisque l’Éritrée ne les avait pas ratifiées que dès le dernier mois du conflit. Donc pour le reste ça ne s’applique pas. Les traités ne s’appliquent pas unilatéralement dans des relations bilatérales. Il y a cependant comme on l’a déjà vu, des traités triangulaires.
Extinction des traités
La terminaison (termination) des traités est le terme juridique spécifique.
Réglementation
CVDT 54-64.
La CVDT vise à assurer l’équilibre entre la volonté étatique et la protection aux tiers. C’est depuis ce point de vue que la CVDT prépare ces solutions. Elle est toujours dans l’équilibre entre volonté et bonne foi.
Suspension
Mesure provisoire. Le traité est préservé, pas terminé. Il est juste pas applicable pendant une période à cause d’un problème comme une violation. Une voie de punition politique sans aller jusqu’à la fin du traité.
Extinction
Définitive.
Mais!
- Seulement rétroactives avec cause de nullité (faute gravissime)
- Quand on suspend/termine on a des dispositions qui ne devraient pas cesser d’exister, comme celles dédiées à régler les différends en cas de violation. Ça serait facile de faire un acte unilatéral de suspension pour détruire la clause compromissoire, donc la CVDT empêche cela (art. 60 4ème paragraphe).
- Selon le paragraphe 5 de l’article 60 la CVDT spécifie que les traités de droit humanitaire/droit de l’homme ne doivent pas être affectés par la suspension/terminaison de la même manière. C’est surtout une question de represailles, les personnes seront toujours protégées.
Motifs d’extinction/suspension
Ceux prévus dans le traité ou dans la CVDT. Le droit coutumier peut aussi prévoir d’autres motifs (la CVDT en faite peut pas juste restreindre la coutume) mais cela n’est pas commun. C’est le cas de la désuétude (un peu comme la pratique subséquente→désigne la situation dans laquelle une norme ou un traité cesse d’être appliqué de façon prolongée et, par la pratique et l’opinio juris (c’est-à-dire la conviction générale que cette règle n’est plus obligatoire), est considéré comme ayant perdu sa force obligatoire.). Le reste de la coutume est comprise dans la CVDT.
Dans la CVDT on reconnaît:
- Volonté d’une partie qui peut s’appuyer sur une norme de doit international (raisons objectives).
- Dans les conflits armés certains traités sont suspendus comme ceux concernant l’amitié ou le financement.
- Succession d’état. Un état qui disparaît ou qui donne un territoire. Les traités qui s’appliquaient à ce territoire se terminent (certains, c’est une matière compliquée).
- Jus cogens. Normes impératives postérieures dérogent le traité sans rétroactivité. Très rare, par exemple les traités d’esclavage.
- Violation substantielle des traités, art. 60.
- La violation ne peut pas juste être peu importante. Un violation substantielle serait laisser d’appliquer le traité ou violer une disposition essentielle sans laquelle le dessin et objectif sont impossibles de réaliser.
- Dès qu’un état commet une violation substantielle l’état est responsable internationalement (responsabilité internationale).
- Dans un accord bilatéral il est possible de suspendre (ceci est possible en partie→cela dépend de si le traité est divisible) ou terminer (pas si facile de le faire en parties). Cela sans rétroactivité. La CVDT spécifie la procédure, l’objectif est de réduire l’unilatéralisme. Sinon il serait facile d’inventer une cause fictive. Si la réconciliation est impossible il est possible de saisir la CIdJ. Cela est fait aussi partie du droit coutumier, mais avec une procédure moins stricte: plus light.
- Dans les traités multilatéraux il faut protéger les états qui n’ont pas violé la traité. Dans ces situations il y a beaucoup d’états et 1 qui viole le traité vis-à-vis d’un autre. La formule n’est pas si simple. Dans le 2ème paragraphe de la CVDT dans l’art 60 (par opposition au paragraphe 1 pour les traités bilatéraux) ceci est spécifié. Une illustration pourrait être:
- Une convention où les parties se mettent d’accord pour terminer le traité après une violation de la part d’un état. La terminaison peut-être soit vis-à-vis d’un seul état soit (dans des cas où par exemple le traité n’a pas de sens sans le violateur) complètement. La CVDT assume que dans ce type de cas l’arbitraire est rare, tout le monde est d’accord. Dans le cas ou ce traité serait bilatéralisable (la majorité des conventions), et donc une partie subit la violation plus fortement que les autres, le paragraphe 1 de l’art. 60 accorde le droit de suspendre mais pas terminer. Le reste des états ont quand même la possibilité de se mettre d’accord, comme spécifié antérieurement.
- Mais si les traités ne sont pas bilatéralisables (traités intégraux ou non-bilatéralisables), il faut adapter les conséquences en tenant en compte sa structure. Ici tous les états sont spécialement affectés. La CVDT prévoit un effet de suspension général.
- Une convention où les parties se mettent d’accord pour terminer le traité après une violation de la part d’un état. La terminaison peut-être soit vis-à-vis d’un seul état soit (dans des cas où par exemple le traité n’a pas de sens sans le violateur) complètement. La CVDT assume que dans ce type de cas l’arbitraire est rare, tout le monde est d’accord. Dans le cas ou ce traité serait bilatéralisable (la majorité des conventions), et donc une partie subit la violation plus fortement que les autres, le paragraphe 1 de l’art. 60 accorde le droit de suspendre mais pas terminer. Le reste des états ont quand même la possibilité de se mettre d’accord, comme spécifié antérieurement.
- Changement de circonstances art. 62.
- Motif de terminaison/suspension selon la CVDT. Un peu ambigu, les circonstances changent constamment et les états avaient beaucoup d’excuses pour en finir avec leur traités. C’est pour cela que cette pratique est domestiquée (doit être compatible avec pacta sunt servanda). Elle ne peut être invoqué à moins que (formulation rare dans la CVDT):
- Certaines circonstances existent au moment de la création du traité et elles sont essentielles pour sa ratification. L’état dénonçant doit démontrer qu’à défaut de ces circonstances il n’aurait jamais adhéré. Il doit démontrer que le changement a été radical. Ex. commun: paix⇒guerre, invoqué souvent mais rarement accepté (jamais).
- Exception: Pour certains traités 100% impossible:
- Traités de frontière.
- Une partie qui viole un traité et amène à un changement de circonstance ne peut pas invoquer ce dernier événement. Personne ne profite de son propre tort.
- Des fois le changement de circonstances n’est pas suffisant pour arrêter le traité.
- Motif de terminaison/suspension selon la CVDT. Un peu ambigu, les circonstances changent constamment et les états avaient beaucoup d’excuses pour en finir avec leur traités. C’est pour cela que cette pratique est domestiquée (doit être compatible avec pacta sunt servanda). Elle ne peut être invoqué à moins que (formulation rare dans la CVDT):
- Raisons subjectives: Consentement des parties de mettre fin (Art. 54)→ Doctrine de l’acte contraire. Cette volonté peut être explicite ou implicite.
- Conclure un traité postérieur pour déroger (ou qui déroge) l’antérieur.
- Résolution pour dissoudre la SdN serait un exemple. Ici c’est pas si explicite, en faite on désigne l’extinction du pacte de la société des nations de 1919.
- Traités commerciaux entre la Russie et le Japon. La Russie devient soviétique et donc laisse le traité de côté, puisque celui-ci était de nature libérale.
- Clause disolutoire/résolutoire (souvent temporelles): Événement X=extinction.
- Quorum: le traité s’éteint si un certain nombre d’état se retirent.
- Dénoncer les traités: Selon l’Art. 56 de la CVDT ceci est possible si le traité en question le prévoit à travers une de ces dispositions. Ceci ne veut pas dire que la dénonciation va résulter dans une extinction. Dans un traité multilatérale elle réduit simplement le nombre de parties. Un traité qui ne prévoit pas la dénonciation n’est pas dénonçable. Mais il y a des exceptions:
- La dénonciation est néanmoins possible même sans clause de dénonciation si une intention implicite des parties ou l’intention du traité indiquent que la dénonciation est prévue/permise. Ceci est compliqué est doit être vérifié selon les faits, le contexte, coutume, etc. Des fois on ne rend pas la possibilité de dénoncer évidente pour ne pas donner des idées (Ex: SDN 1930ss, avec l’Allemagne et l’URSS, etc.).
- Tous les traités économiques sont dénonçables, ils sont mouvants par nature.
- Neutralité est aussi dénonçable.
- De la même manière:
- Les accords sur les frontières sont impossibles de dénoncer par nature.
- Pour qu’un traité soit éteint ou suspendu, il faut une manifestation claire et formelle de la volonté des parties (par exemple, via une dénonciation ou une notification de retrait conformément aux dispositions du traité ou de la Convention). La simple rupture des relations diplomatiques (sauf si elles sont nécessaires pour appliquer le traité), qui relève souvent d’une décision politique, ne remplace pas cette volonté objective exprimée par les mécanismes prévus par le droit des traités. Art. 63.