Introduction au DIP
Définition
Le DIP est constitué par:
- C’est un ordre juridique (ensemble de règles, ordre normatif qui est composé de prescriptions qui vous disent quoi faire: règles de procédure, institutions pour administrer des fonctions sociales/font la gouvernance et règles qui les régissent bien évidemment) qui régit les relations entre états.
- Ces règles juridiques sont contraignantes sous peine de sanction. On n’est pas libre de respecter ou ne pas respecter une règle de droit dès qu’on est engagés soit par self-obligation ou imposition de l’état.
- La sanction peut être visible (police, institutions de faillite, etc). La sanction du DIP était souvent la guerre avant. Il y a beaucoup de sanctions dans le DIP mais elles sont décentralisées et pas tellement visibles, noyées dans la politique.
Le DIP est un ensemble de règles emboîtées, elles fonctionnent dans un ensemble. Par exemple vous avez le droit des traités. Quand on fait un traité, si on le viole le droit de responsabilité (en général des règles dans le DIP quoi) dans le DIP te sanctionne. Tout est connecté, plusieurs blocs s’entre aident.
Sujet
À qui s’adressent ces règles? Avant tout, aux états. Mais pas exclusivement, seulement en grande partie et il y a des règles qui ne s’adressent qu’à eux. Le DIP est fondamentalement inter-étatique. C’est un ordre plat/horizontal. Il régit les relations entre des égaux. Mais nous on est soumis à l’état Suisse dans le droit interne, les règles sont faites qu’on le veuille ou non.
En DIP il n’y a pas un état mondial, pas d’entité supérieure qui légifère (même pas l’ONU). Les états font des accords entre eux selon leur opinions. C’est un ordre fragmentaire d’interaction, mobile et sans un leader auquel les autres sont soumis.
Il y a d’autres sujets comme les ONGs qui n’existent que grâce aux traités, grâce aux DIP. L’ONU, contrairement aux états qui ont leur règles intérieures, est que régie par le DIP. Les belligérants sont aussi des sujets du DIP (groupes armés.). Où d’autres acteurs comme le CICR (qui a certains pouvoirs sur les états), tel que les conventions de Genève l’ont crée. Le DIP régit aussi les accords entre le CICR et certains états. Mais le DIP est fait par et pour les états.
L’ordre juridique international ne régit qu’un certain nombre d’interactions entre les états, toutes les RI ne sont pas régies par le DIP. Il y a des domaines dans lesquels les états restent libres, sans règles juridiques. Certains états ne ratifient par exemple pas certains traités donc il ne sont pas soumis à eux.
Évolution
L’évolution la plus marquante depuis le 19ème c’était le passage du DIP classique (19ème) au moderne (celui du 20ème siècle).
Classique
États très libres. Ce DIP se limite aux négociations (ambassades par exemple), transactions (traités) et guerre. Les négociations, les résultats de celles ci et les possibles guerres.
Le multilatéralisme n’est pas prévu, c’est plutôt bilatéral. C’est un droit pour coexister et pas nécessairement pour coopérer. La souveraineté territoriale et le pouvoir dans la guerre y sont notés entre autres choses. L’annexion, colonialisme, aggression, etc, ne sont pas interdits. Au 19ème tout cela était admis.
Il est basé sur (et reconnaît) l’inégalité entre les états (grandes puissances contre les petites+ colonialisme et traités inégaux comme ceux de la Chine). Il est fondamental, il existe pour servir les états dans leur négociations et arriver à leur intérêt. C’est un instrument pour les ambitions/prédations des états. Il y a pas d’organisation internationales, c’est inorganique sauf quelques organisations techniques comme des congrès entre états.
Moderne
La SdN est créée et le multilatéralisme apparaît au 20ème siècle aussi. 1919 pacte de la SdN + 1945 pacte des Nations Unies. Tout d’un coup il commence à tout régir (aviation civile, brevets, etc). Il y a une extension matériale du DIP énorme, il y a presque rien où le DIP n’influence pas le droit interne, tout comme les états l’ont voulu puisqu’ils ont fait tous ces traités volontairement. La coexistence existe toujours mais le multilatéralisme avance et la coopération pour solutionner les problèmes communs apparaît (des conférences globales et traités multilatéraux, etc.).
Il y a des règles pour l’autodétermination, l’utilisation de la force, etc. Les états sont plus contraints pour arriver à réaliser des objectifs collectifs. Maintenant les états sont égaux→ décolonisation et etc.
Un grand nombre d’organisations (+300 inter-étatiques) apparaissent. Mais il y a aussi les meetings, programmes conjoints, etc. Des milliers d’organisations internationales.
21ème siècle
On est en train de revenir au classique? On n’efface pas le moderne mais on revient au bilatéralisme, vers un nouveau DIP centré sur les intérêts de chaque nation. Ceci ne donne pas beaucoup de résultats normalement.
Efficacité
Il y a une réflexion idéaliste qui dit que le monde est régi par le droit. Ou qu’il devrait être régi par celui ci. Un monde sans droit serait un monde régi par la force. Mais le DIP est crée grâce à la guerre et ses premières règles régissent la guerre.
Mais le monde n’est pas régi par le droit. Il est régi par la politique. Ceci pourrait ne jamais changer. Ceci ne veux pas dire que le DIP n’existe pas, mais qu’on ne vit pas dans une utopie. Quoi qu’on fasse pour nos intérêts on ne peut pas se passer des outils du DIP. Trump veut des accords (du DIP), la Suisse veut régler les choses avec l’UE (tribunal d’arbitrage, bilatéraux, etc→ DIP). On ne peut pas avoir des relations sans du DIP. On ne peut même pas avoir des avions sans la convention du vol civil international→DIP. Le monde est régi par le DIP, quoi qu’on fasse on n’y échappe pas.
Il y a des états qu’y en abusent même. La Russie l’utilise comme pretexte pour son opération en Ukraine (légitime défense, etc). L’objectif de ce cours est voir le DIP comme un outil qui peut être utilisé, bien qu’il ne régisse pas le monde. Les états font du DIP tous les jours. Quelques traités sont violés, mais pas la majorité. Tout ce qu’on fait politiquement a une dimension juridique. La politique et le DIP sont très liés, c’est un instrument le DIP et on peut l’utiliser mal (affaiblir) ou bien (renforcer) pour la politique.
Sources du droit international
Il y a un vocabulaire singulier: les fontes (sources). Quand on a un ordre juridique on doit faire des règles, le DIP ne tombe pas du ciel. C’est les sources. De la même manière que la constitution ou la coutume est une source de droit interne.
Il y a pas un ordre juridique vertical. En DIP y a pas de législateur et donc pas de lois. Le vocabulaire est important. Il a pas de légalité, mais de licité. Puis qu’on est dans un ordre décentralisé les sources sont l’accord (traité) et la coutume (choses que même sans traité on a toujours fait d’une certaine manière). Il y a aussi les principes généraux du droit (moins importants que les deux autres sources). La doctrine et la jurisprudence sont aussi des sources (bien que moins importantes). Ce sont des sources auxiliaries moins importantes que les trois premières (même les principes généraux sont plus importants). Si la coutume, par exemple, ne peut pas nous aider on peut consulter ces sources auxiliaires. Il est possible de fonder une décision sur un traité ou coutume mais par sur (par exemple) une thèse d’un certain auteur (partie de la doctrine).
La CIdJ est le tribunal principal de DIP. Elle examine ces sources.
Termes importants
Sources formelles vs matérieles
Les premières contiennent des règles qui peuvent être appliquées (coutume+traités). Elles font le droit. Les deuxièmes sont les raisons pour lesquelles on a adopté les premières. C’est la volonté, par exemple en finir avec l’inflation. Elles ne sont pas du droit mais elles l’expliquent, c’est pour cela qu’elles sont prises en compte. C’est utile pour l’interprétation selon l’objet/but de la règle.
Sources primaires vs secondaires
Il y a un emboîtement:
- La source primaire d’une ONG est un traité. L’ONU a été créée par un traité qui est la Charte des NU. On peut pas créer une ONG ou un forum de coopération international sans du DIP.
- Ce traité instaure des organes, avec des pouvoirs concrets. Par exemple le CdS peut prendre des décisions contraignantes. Le CdS est une source secondaire/dérivée. Elle doit s’en tenir à la charte (source primaire) pour être valide. Elle ne peut être créée qu’en vertu de la source primaire.
Sources vs normes
Les sources c’est le contenant, la manière de créer des règles dans des catégories particulières. Un traité/accord entre états est une source. Ils contiennent du droit, des règles juridiques. Ces normes dans les traités comme les droits des douanes peuvent êtres réclamés par les états ratifiant le traité en sorte que celle ci soient respectées.
Le droit applicable
Quand on résout un cas de DIP on doit déterminer le droit applicable à la situation qui nous est soumise. Ceci nous permet de donner la réponse correcte. C’est le droit applicable dans cette situation plutôt que d’autres. Par exemple la protection des civils. Quel protocole ou règle s’applique? Il ne disent pas exactement la même chose pourtant. Certains protocoles sont applicables puisque les deux états concernés l’ont ratifiés (droit spécial supérieur au droit général). S’il n’y a pas de traite ratifié on passe au droit coutumier. Peut être que le traité a été ratifié après le crime/situation. Mais celui-ci n’est pas rétroactif donc pas applicable.
Si un traité (ou une disposition particulière d’un traité) vise précisément la situation factuelle rencontrée, et que ce traité est en vigueur pour les États concernés, ce traité spécial écarte l’application d’une règle générale de droit international (qu’il s’agisse d’un autre traité plus général ou d’une règle coutumière plus générale).
Droit (international) général ou droit (international) particulier
Le champ d’application diffère. Le général s’applique à tous les états (comme les normes coutumières comme l’immunité des diplomates). Le particulier s’oppose à ce dernier, il ne s’applique qu’à quelques états. Il est à géométrie variable (comme les traités, qui ne concernent que ceux qui les ratifient).
On fait des distinctions quand le champ d’action diffère. Mais en plus, dans ce cas le particulier prime le général.
Violations
Le DIP a été violé en Ukraine? L’important c’est pas tellement les violations. Si on a des règles c’est puisqu’elles peuvent être violées. Le DIP donne aux états la possibilité de la légitime défense (même collective) et de soutenir la légitime défense. Ceci donne aux états l’opportunité de faire des choses qu’ils ne pourraient pas normalement. C’est ça les sanctions.
Les états on aussi put prendre des sanctions envers la Russie, qui ne pourraient pas faire sans le DIP. Il faut être capable de voir au delà des violations. En plus il y a plein de traités qui sont respectés et marchent (des milliers), le DIP n’est pas toujours violé et marche très bien.
Hiérarchie
Est une source supérieure à une autre?
Ceci est intéressant surtout en cas de conflict. Si on a une règle de droit coutumier et de droit d’ordre conventionnel (un traité par exemple) qui nous disent le contraire, quoi faire?. Dans ce cas il n’y a pas une source qui l’emporte sur l’autre. Le traité est particulier mais une coutume peut aussi être du droit particulier. On n’est pas supérieur ou inférieur selon la catégorie de la source mais selon les normes. Les sources sont inégales dans les états puisque les organes qui les font n’ont pas la même autorité. Néanmoins, dans le DIP il n’y a pas d’état. Tous les états existent dans une totale égalité. La coutume, les traités, etc; sont toutes des sources faites par ces états et donc elles ne devraient pas exister sur un plan vertical. Ceci au moins pour les sources principales.
Donc, comment résoudre les conflits
Il n’y a pas des conflicts entre sources, elles sont égales. Mais au niveau des normes oui. Il y a des différentes techniques pour résoudre cela:
- Générales: découlent de l’interpretation et varient selon le cas.
- Spéciales: découlent de normes/règles particulières. Il y a des cas dans lesquels le conflit a été prévu par le législateur et donc on peut le résoudre en faisant attention à des normes spéciales. S’il n’y a rien de tel le juriste doit travailler.
Art 103 de la Charte des Nations Unies (Spéciale)
En cas de conflit des obligations dans cette charte avec un autre traité on priorise la charte. Sans cet article on pourrait contourner les sanction en faisant un traité postérieur à la charte.
- Disposition n'est pas une obligation:
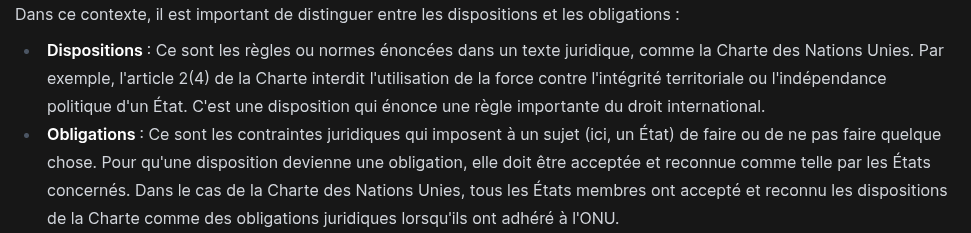
Jus cogens (Spéciale)
Il y a certaines règles de droit coutumier qui sont tellement importantes qu’elles ne peuvent pas être dérogées (remplacées par le droit particulier). On peut par exemple pas faire un accord pour commettre un génocide.
Présumer l’absence de conflit (Générale)
On essaie d’interpreter deux règles apparemment contraires comme compatibles. Par exemple quand un état a voulu les deux règles, le juriste essaie de sauver les deux et donc de respecter la volonté des états.
Exemple: Le gel des actifs terroristes par le conseil de sécurité et le droit de l’homme à la propriété. Interpretation harmonisatrice:
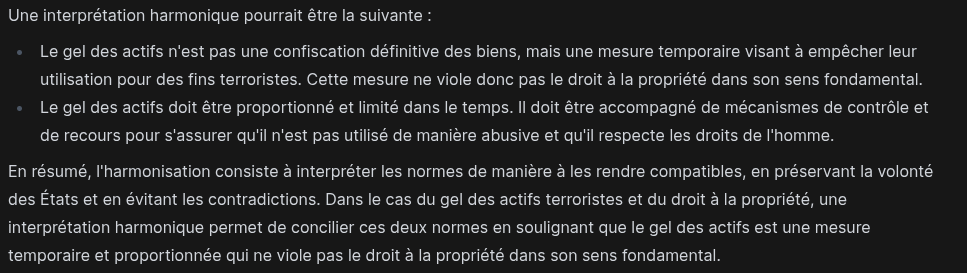
Mais si on ne peut pas harmoniser, on peut toujours utiliser autres techniques→
La règle plus spéciale l’emporte
… sur la règle la plus générale. Exemple: Si deux états adoptent un traité contraire à une norme c’est bien entendu parce qu’ils veulent faire autrement. Sinon ils laisseraient les normes du droit général tel qu’elles sont. La volonté des états pour s’écarter du droit général prime.
Lex spetialis derogat legi generat
Le droit postérieur l’emporte
… sur le droit antérieur. La volonté plus récente l’emporte sur l’ancienne, qu’on a manifestement rejetée puisqu’on a fait des nouvelles règles contraires à celle-là.
Lex posterior derogat legi priori
Mais
Ceci n’est pas mécanique mais sujet à interprétation. Par exemple, le droit plus spécial peut être antérieur au droit général. On peut donc dire, comme c’est normalement le cas, que le droit général postérieur ne déroge pas le droit spécial antérieur.
Les accords et les traités
Ils l’emportent, normalement. Cependant: accord, traité et convention c'est pas la même chose. Des fois il y a aussi charte ou pacte (de la SdN), ou même déclaration, concordat, change de note, modus immondi, procès verbal, arrangement, etc. Tous ces termes peuvent désigner des traités. Ils sont non-interchangéables. Ils veulent dire des choses différentes, même si leur message est perdu dans la politique. Il est parfois difficile de savoir.
- Traité: accord écrit. Il n’y a pas des traités oraux.
- Convention: traité multilatéral. Mais il y a des cas ou la définition se confond avec celle de traité.
- Accord: Peut même être oral, couvre le bilatéral et multilatéral.
- Protocole: Se greffe sur quelque chose de préexistant. Pour être partie du protocole il faut faire partie du texte original. C’est une suite.
- Concordat: traités du Vatican (sujet particulier du DIP) à caractère religieux.
Il faut analyser la volonté des états créateurs/signataires et le contenu des traités pour pouvoir vraiment distinguer le type de texte au delà de leur nom.
Il y a des traités qui ne sont plus en vigueur, comme les traités d’amitié suisses du 19ème siècle qui ne sont plus appliqués mais pas éliminés dans un acte par empathie politique (exemple: réaliser un acte pour en finir avec un traité d’amitié). Il y a environ 100 000 traités endormis. Il sont très utiles et donnent plus de marge de manœuvre que le droit général.
Définitions
Comme définir un traité? Dans un contentieux où on essaie de savoir quel droit s’applique on doit déjà utiliser et savoir définir les traités. Dans la convention sur les traités de vienne on a essayé de régir toutes les questions sur les traités:
- Le nom du traité ne compte pas beaucoup, ce qui compte c’est un accord entre deux états ou plus. Donc international.
- Il doit être écrit. Dans le droit intérieur c’est pas nécessaire.
- Elle régit que certains traités, le reste c’est par le droit coutumier.
- Objectif de refléter le droit général (mêmes objectifs et 4 points)
- Obligations de procédures pour les parties ratifiantes.
Il y a des accords où on peux appliquer le droit coutumier (pas régis par cette convention). Il y a une autre convention de vienne pour les traités (86) entre OIs et états ou OIs. Elle n’a jamais entré en vigueur (pour le moment c’est pas du droit positif). Si elle rentre en vigueur et ben les traités des OIs seront régis par elle. Les traités entre la Suisse et la France sont régis par la coutume, la France n’a pas signé la convention de Vienne. Cette convention s’applique si:
- Le traité est postérieur à la convention.
- Les états dans le traité ont ratifié la convention.
- Le traité rentre dans la définition de traité de la convention.
En droit général
4 éléments qui constituent (cumulatifs) un traité dans la pratique générale des états:
- Volontés concordantes entre les différentes parties. Par exemple dans les bilatéraux il y a des offres→réactions→acceptations réciproque.
- Il y a aussi des textes élaborés collectivement dans des conférences. Ceux qui votent oui/ratifient sont régis par les traités.
- Celui qui donne la concordance doit être une personnalité juridique. Les états sont ceux qui ont le droit de faire les traités (droit automatique qui n’est pas otorgué mais donné toujours). Les OIs peuvent aussi, mais seulement sur les matières sur lesquelles elles possèdent des compétences. C’est le jus pactatus. L’individu ne l’a pas. On fait des accords avec des états (entreprise-état, état-individu, etc) mais c’est pas des traités.
- Rwanda-RDC (2006). Le ministre de justice signe un traité pour régir les armements. La CIdJ n’exclue pas l’implication de l’état dans certaines circonstances par le ministre de justice en tant que représentant de celui ci dans une négociation.
- Si les autorités sont dépendantes, il n’est pas possible de faire des accords. Par exemple les colonies de l’UK ne peuvent pas (selon la CIdJ) faire des accords avec l’UK pour la décolonisation.
- Accord de Lancaster (UK-Maurice). La CIdJ a conclu que c’était un accord de droit constitutionnel britannique et pas un traité international.
- Il y a une volonté à modifier la situation juridique. Donner/Enlever des droits et etc. Il y a des textes faits comme des traités (gentlemans agreements) mais ne le sont pas, c’est pas un lien politique. C’est juste se mettre d’accord sur quelque chose pour la présenter à la presse par exemple. Comme Helsinki et les tensions ouest/est d’Europe. Les états savent qu’ils doivent être attentifs quand ils font/ne font pas du droit. La contrainte n’est pas la même. Ils ne font pas du droit par accident. Ceci influence aussi la manière dont le texte est rédigé, soit avec des mots mous (par exemple: s’efforcer) ou durs (par exemple: devoir).
Sans ces qualités on a un contrat mais pas un traité. Par exemple quand on vend un avion ou du matériel entre états on fait des contrats, qui sont moins difficiles à faire et à accepter (pas besoin de passer par le parlement entre autres). Et ces contrats ne sont pas soumis au DIP mais au droit intérieur. Le droit des traités n’est pas applicable.
Formalisme
Peuvent les traités être conclus, comme dans le cas du désarmement, avec de la pompe? Cela veut dire, avec une procédure très diplomatique. Bien sûr. Des fois c’est tout le contraire, on le fait informellement pendant un dîner. Le formalisme n’est pas demandé ni particulièrement nécessaire. Médiation de l’affaire Qatar-Bahreïn. L’Arabie Saoudite prenait le procès-verbal et considérait qu’il était possible de saisir la CIdJ. Une fois que les deux parties étaient d’accord et que le procès-verbal était signé par les deux, c’était un traité (seulement puisque c’était les ministres des Affaires étrangères et pas des simples délégués).
Le droit des traités
Le droit ne contient pas des règles rigides pour comment faire un traité. Il y a de la souplesse. Cependant il y a certaines directrices formées au fur et mesure du temps. Les états ont identifiés un problème commun, et ils négocient. On sait pas quelle va être la conclusion. Mais qui peut négocier pour un état?
- Plein pouvoirs (inexacte juridiquement, on peut envoyer des gens avec des pouvoirs limités en leur disant quoi faire en avance). On leur donne à des personnes que les états sont libres de choisir. Ils leur donnent une lettre de plein pouvoir: X a été désigné pour représenter Y dans l’événement A.
- Certaines personnes ont des pleins pouvoirs inhérents à leurs fonctions (la convention des traités mentionne aussi ce point). Les chefs d’état, les chefs de gouvernement et les ministres d’affaires étrangères. Ils l’engagent avec leur paroles, ils doivent attention. C’est la troïka.
- En Suisse en réalité on a pas cette troïka. On a juste 2 personnes (président de la CH) et pas 3 (puisqu’on a un chef d’état et de gouvernement à la fois). Et quand le président et aussi ministre des affaires étrangères on en a que 1.
- Les ambassadeurs ont aussi ces pouvoirs pour les traités bilatéraux. Il y a des autres normes et etc mais en général la lettre de pleins pouvoirs est nécessaire.
- Certaines personnes ont des pleins pouvoirs inhérents à leurs fonctions (la convention des traités mentionne aussi ce point). Les chefs d’état, les chefs de gouvernement et les ministres d’affaires étrangères. Ils l’engagent avec leur paroles, ils doivent attention. C’est la troïka.
D’esengorgement des affaires étrangères
Certains états permettent aux ministres de faire des traités sans le département des affaires étrangères ou le chef d’état. Peut-il faire ceci? Ça pose des problèmes de transparence. Des fois un ministre de défense n’est pas compétent dans tout mais un ministre des affaires étrangères oui. Mais de nos jours trop de traités sont faits, il est impossible de tout faire passer par les affaires étrangères.